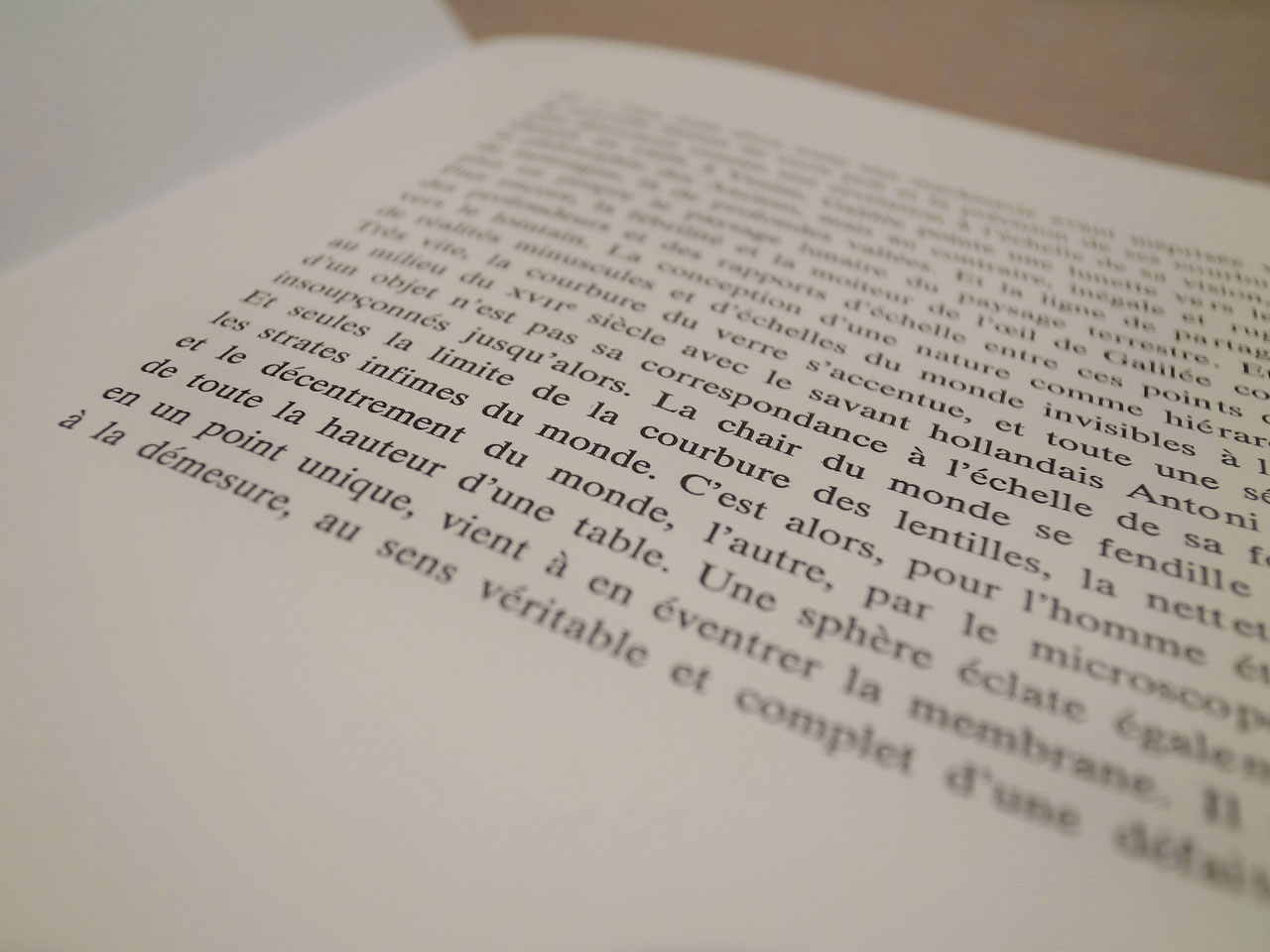Dimanche 4 décembre 2011. Photos numérisées à partir de diapositives prises en juillet 1962 à l’aéroport d’Orly (voir le texte ci-dessous). Appareil photographique : Exa II, objectifs de 50 mm et 135 mm, film Kodachrome.
–
Dimanche à Orly, une chanson de Gilbert Bécaud en témoigne, l’aéroport d’Orly est, au début des années soixante, un monument qui concurrence la Tour Eiffel. Cette terrasse, d’où l’on voit les avions, reçoit chaque année des millions de visiteurs qui ne sont pas des passagers. Alors que le bâtiment est perçu comme accomplissement de la modernité architecturale accompagnant la démocratisation des voyages en avion, il se révélera comme témoin du changement de paradigme qui voit passer de l’époque des énergies transformatrices à celle des technologies de la communication. Au demeurant, la Tour Eiffel aussi devait sensiblement changer de statut en passant du monument à la révolution industrielle à l’emblème de la diffusion rayonnante de la télévision.
Au cours de l’été 1962, je visitai Paris pour la deuxième fois. Si le premier voyage avait inclus Le Louvre et la Tour Eiffel, le point d’orgue du deuxième fut l’aéroport d’Orly. Je ne sais plus quelles circonstances firent que cette visite ait lieu à la nuit tombée. Mes photographies en témoignent. Et il est vrai que je tenais à faire ces images pour mémoire. La même année, la longue terrasse des visiteurs d’Orly donnait son titre au film de Chris Marker, La Jetée. L’adolescent que j’étais eu donc, une fois le film découvert, quelque temps après, de bonnes raisons d’entrer en résonance avec le « Ceci est l’histoire d’un homme marqué par un souvenir d’enfance » qu’annonce son prologue. Le cinéma de La Jetée renonce au mouvement interne des images au bénéfice du pur montage, autrement dit à la mobilité spatiale pour atteindre une mobilité dans l’espace du temps. C’est le flux musical du texte du récitant qui articule la suite des images fixes. Film de science-fiction, La Jetée préfigure la « profondeur de temps » de Paul Virilio, comme son assertion : « Tout arrive désormais, sans qu’il soit nécessaire de partir. » (1) Lorsqu’il se remet en mouvement, l’homme court sur la jetée, vers l’image de la femme aimée, sous le regard du jeune garçon qu’il a été, vers sa propre mort.
« Fragments d’un film tourné en 1964 » est le sous-titre du film Une Femme mariée, de Jean-Luc Godard. Le film s’ouvre sur une suite de plans fixes, cadrant, en gros plan et sur fond blanc, des fragments des corps d’une femme et d’un homme. Cette suite sera reprise à la clôture du film, situant cette fois la femme et son amant dans un hôtel de l’aéroport d’Orly. Godard étire en longueur le moment, tout en refusant de lui donner la continuité d’une action. Vues en suspens, vues qui tendent vers l’immobilité. Elles contrastent avec les séquences qui précèdent, où l’héroïne court à travers Paris, tombe, saute d’un taxi à l’autre comme pour brouiller les pistes, retrouve son amant dans le cinéma permanent d’Orly, traverse les galeries de l’aéroport en se retournant sans cesse. Le mari est pilote, toujours parti. On le voit pour la première fois rejoignant sa femme et son enfant sur le tarmac, mot magnétique, site symbolique, qui n’est ni l’aéroport ni la piste, lieu des transitions instables, des retrouvailles, des négociations, des retours d’otages. En dépit de son aspect brutalement technique, le tarmac est en effet un théâtre de la parole, où toute relation s’inscrit dans le langage. On se rappelle la scène pivot de North by Northwest (Hitchcock, 1959), où le chef des services secrets révèle au héros, Thornhill alias Kaplan (Cary Grant), alors qu’ils marchent dans la nuit, sur le tarmac, vers leur avion, le rôle qu’il attend de lui, c’est-à-dire la trame entière d’un film qui enchaîne tous les moyens de transport. Nous, spectateurs, savons déjà l’essentiel, et peut-être nous laisse-t-on encore dans l’ignorance. Alors, nous n’entendons rien de cette conversation : elle est couverte par le bruit des moteurs, emportée par le vent des hélices. Dans la chambre de l’aéroport, on y revient, c’est la parole qui définitivement prend le relais du mouvement, c’est la langue, le texte. Lui est comédien. Il parle du théâtre par comparaison avec la vie. Il dit un passage de Bérénice. Ces personnages immobiles sont mobilisés par les codes du langage. C’est la voix encore qui situe la chambre dans l’aéroport, ces annonces du mouvement des vols au timbre si singulier qui imposèrent durablement l’imaginaire de l’aéroport moderne. Et son attractivité sensuelle probablement. On allait à Orly pour entendre cette voix féminine.
Le film Playtime, de Jacques Tati, 1967 débute et finit lui aussi à l’aéroport d’Orly. Il s’ouvre sur la vue générale, quasi axonométrique, d’un lieu indéterminé, énigmatique. C’est un vaste hall moderniste et gris. Quelques stéréotypes de personnages, aperçus rapidement, évoquent un asile, un hôpital. Puis, à la faveur d’un élargissement imperceptible du cadre, des éléments de signalétique apparaissent, qui apparentent le décor à une aérogare. On entend les fameuses annonces. Le ton monte, l’espace s’anime, on revoit les mêmes personnages, ensemble, dans leur fonction révélée, jusqu’au débarquement d’un groupe de touristes. Dans une séquence suivante, un espace comparable est celui d’un monde de bureaux, interminable, désert. Le personnage joué par Tati a un rendez-vous. Pour trouver son interlocuteur, un gardien va appliquer toute une procédure sur un tableau de boutons électriques. Et l’on peut rappeler ici le tableau lumineux en forme de plan qui, dans le film de Godard, indique les places occupées à l’entrée de la salle de cinéma d’Orly.
La Tour Eiffel, selon Roland Barthes, dans un texte célèbre contemporain de ces trois films, est l’instrument qui pousse à une activité, qui donne à lire, à déchiffrer (2) l’espace urbain perçu comme panorama. Mais déjà, à l’inverse, le dispositif de l’aéroport fait de ceux qu’il attire par la promesse du spectacle de la mobilité, les objets d’une lecture, d’un décryptage, d’une inscription dans un réseau de circulation, où, paradoxalement, ils subissent une forme d’immobilité.
Après un demi-siècle, je suis devenu un habitué des long-courriers. J’ai vu, du ciel, des paysages formidables en Iran, en Sibérie ou au Groenland. Il m’est arrivé, pour passer le temps, de regarder des films. Mais j’ai désormais le goût d’une image qui atteste du voyage : l’écran que chaque passager a sous les yeux, qui affiche les données du vol et surtout la position de l’avion sur des cartes. À l’époque de ce qu’on peut nommer la dictature du temps réel, car ce « temps réel » nous impose globalement une actualité qui ne nous concerne pas, voilà au moins une situation qui m’implique individuellement. C’est une situation de lecture : Durée de vol restante : 7:02; Heure d’atterrissage : 16:37; Distance restante : 5817 km; Oulan-Bator; Novosibirsk; Yekaterinburg; Arkhangel’sk; St Petersburg; Helsinki; Uppsala; etc.
1. Paul Virilio, L’Inertie polaire, Bourgois, 1990, p. 180.
2. Roland Barthes, La Tour Eiffel, Delpire, 1964, pp. 38-43
Extrait de « Les immobiles », texte à paraître dans Habiter les aéroports, Métis-Presses, Genève, 2012.
Voir « Les immobiles », jlggbblog décembre 2007 : http://jlggb.net/blog/?p=95



Chris Marker, La Jetée, 1962. Voir jlggbblog « La Jetée (Tokyo) » : http://jlggb.net/blog/?p=100



Jean-Luc Godard, Une Femme mariée, 1964, Bernard Noël, Macha Méril, photographie par Raoul Coutard.
Voir jlggbblog2, le Printemps Nation : http://jlggb.net/blog2/?p=5812


Jacques Tati, Playtime, 1967, Jean Badal, Andréas Winding, directeurs de la photographie.